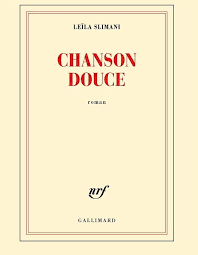Résumé : « «Louise ? Quelle chance vous avez d’être tombés sur elle. Elle a été comme une seconde mère pour mes garçons. Ça a été un vrai crève-cœur quand nous avons dû nous en séparer. Pour tout vous dire, à l’époque, j’ai même songé à faire un troisième enfant pour pouvoir la garder.» Lorsque Myriam décide malgré les réticences de son mari de reprendre son activité au sein d’un cabinet d’avocats, le couple se met à la recherche d’une nounou. Après un casting sévère, ils engagent Louise et sont conquis par son aisance avec Mila et Adam, et par le soin bientôt indispensable qu’elle apporte à leur foyer, laissant progressivement s’installer le piège de la dépendance mutuelle. »
Et bien, ça faisait longtemps que je n’avais pas dévoré un roman aussi rapidement. Le premier mot qui me vient en ayant lu les dernières lignes de cette œuvre c’est glaçant. On s’immisce dans la tête du personnage principal, qui pour une fois n’est pas le gentil de l’histoire, avec une facilité déconcertante, et les émotions des personnages, de manière générale, traversent le lecteur de part en part.
L’histoire est inspirée d’un terrible fait divers, qui a eu lieu à Manhattan en 2012. Yoselyn Ortega, 50 ans au moment des faits, tue les deux enfants dont elle avait la charge, Léo, deux ans, et Lucia, six ans, avec un couteau de cuisine, dans la salle de bain, avant de tenter de mettre fin à ses jours en se tranchant la gorge. C’est sur ce tableau morbide que s’ouvre le roman.
Une scène macabre, le cri de désespoir de Myriam qui résonne silencieusement dans nos oreilles. Puis l’histoire commence, remontant au début de la maternité de Myriam. On apprend à connaître le couple, leurs enfants, les problématiques liées à la maternité que rencontrent beaucoup de mères, l’envie de retrouver du temps pour soi, pour son travail, la culpabilité de ne pas s’occuper de ses enfants soi-même. On assiste alors à la décision du couple d’engager une nourrice et on rencontre Louise, parfaite sous toutes les coutures. Mais tout de suite, elle a quelque chose dérangeant. Assez rapidement, on en vient à la détester, c’est épidermique. On a envie d’alerter Paul et Myriam, et plus le roman avance, plus ça devient oppressant. On découvre au fil des pages l’histoire, le passé de Louise, qui ont fit d’elle ce qu’elle est devenue. On comprend, même si la compassion et l’empathie pour le personnage sont difficiles à ressentir. On voit son incapacité à être mère, à être maître de sa vie, sa solitude pesante, envahissante et tout cela rejaillit sur son être social et sur sa volonté d’être parfaite au travail.
Insidieusement, le lien d’interdépendance s’installe entre la nounou, les enfants et la famille. Et même si Paul et Myriam sentent à plusieurs reprises que quelque chose cloche, ils ont trop besoin d’elle et de la vie qu’elle leur offre pour la renvoyer. Et finalement, la perspective de devoir se séparer de cette famille devient pour Louise impossible, tant son implication dans leur quotidien est devenue sa bouée de sauvetage, au point qu’elle vit par procuration et qu’elle menace de perdre pied à tout instant.
On tourne les pages de ce livre avec frénésie, impatients de connaître les raisons qui ont poussé Louise à commettre ce double meurtre atroce, et on entre dans la vie des personnages du roman avec un espèce de voyeurisme délicieux, à travers un lyrisme sombre et percutant. En tant que parents, on se met sans doute encore plus facilement à la place de Paul et Myriam, et on voit le dénouement approcher, inéluctable, la boule au ventre. Pour moi, Chanson douce est une très belle œuvre littéraire et sans conteste une réussite.
Conseils de lecture :
– Les bonnes (Jean Genet) : « Genet nous avertit. Il ne faut pas prendre cette tragédie à la lettre : «C’est un conte, c’est-à-dire une forme de récit allégorique.» «Sacrées ou non, ces Bonnes sont des monstres. Elles ont vieilli, elles ont maigri dans la douceur de Madame. Elles crachent leurs rages.»
Les domestiques sont des êtres humiliés dont la psychologie est perturbée. Austères dans leur robe noire et souliers noirs à talons plats, les bonnes ont pour univers la cuisine et son évier ou la chambre en soupente, dans la mansarde, meublée de deux lits de fer et d’une commode en pitchpin, avec le petit autel à la Sainte Vierge et la branche de buis bénit.
Genet a réussi cette pièce, Les Bonnes, peut-être parce qu’il revivait, à l’intérieur de ses personnages, en l’écrivant, sa propre humiliation. »
– Dans le jardin de l’ogre (Leïla Slimani) : « Une semaine qu’elle tient. Une semaine qu’elle n’a pas cédé. Adèle a été sage. En quatre jours, elle a couru trente-deux kilomètres. Elle est allée de Pigalle aux Champs-Élysées, du musée d’Orsay à Bercy. Elle a couru le matin sur les quais déserts. La nuit, sur le boulevard Rochechouart et la place de Clichy. Elle n’a pas bu d’alcool et elle s’est couchée tôt.
Mais cette nuit, elle en a rêvé et n’a pas pu se rendormir. Un rêve moite, interminable, qui s’est introduit en elle comme un souffle d’air chaud. Adèle ne peut plus penser qu’à ça. Elle se lève, boit un café très fort dans la maison endormie. Debout dans la cuisine, elle se balance d’un pied sur l’autre. Elle fume une cigarette. Sous la douche, elle a envie de se griffer, de se déchirer le corps en deux. Elle cogne son front contre le mur. Elle veut qu’on la saisisse, qu’on lui brise le crâne contre la vitre. Dès qu’elle ferme les yeux, elle entend les bruits, les soupirs, les hurlements, les coups. Un homme nu qui halète, une femme qui jouit. Elle voudrait n’être qu’un objet au milieu d’une horde, être dévorée, sucée, avalée tout entière. Qu’on lui pince les seins, qu’on lui morde le ventre. Elle veut être une poupée dans le jardin de l’ogre. »